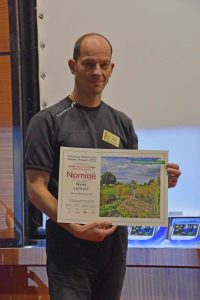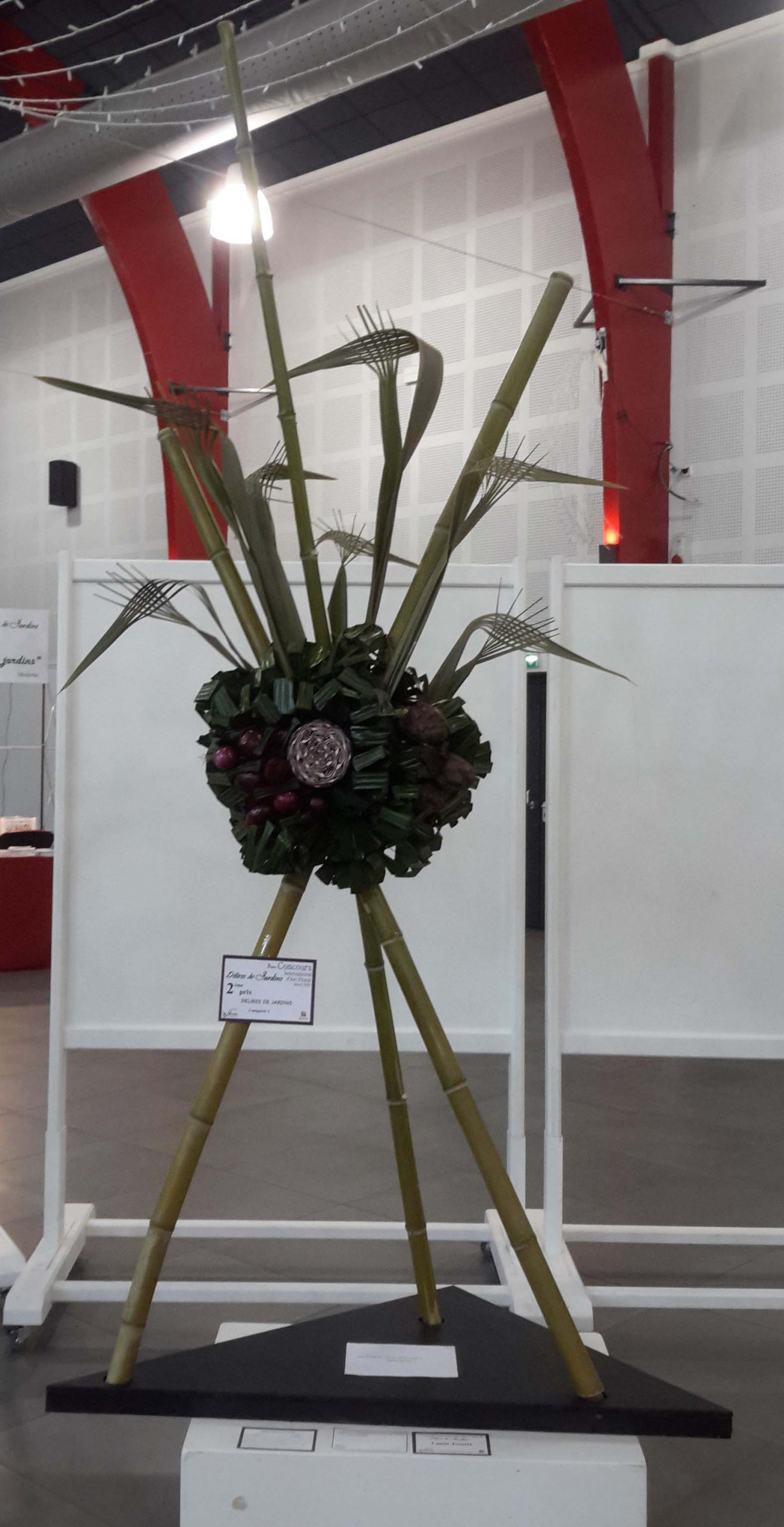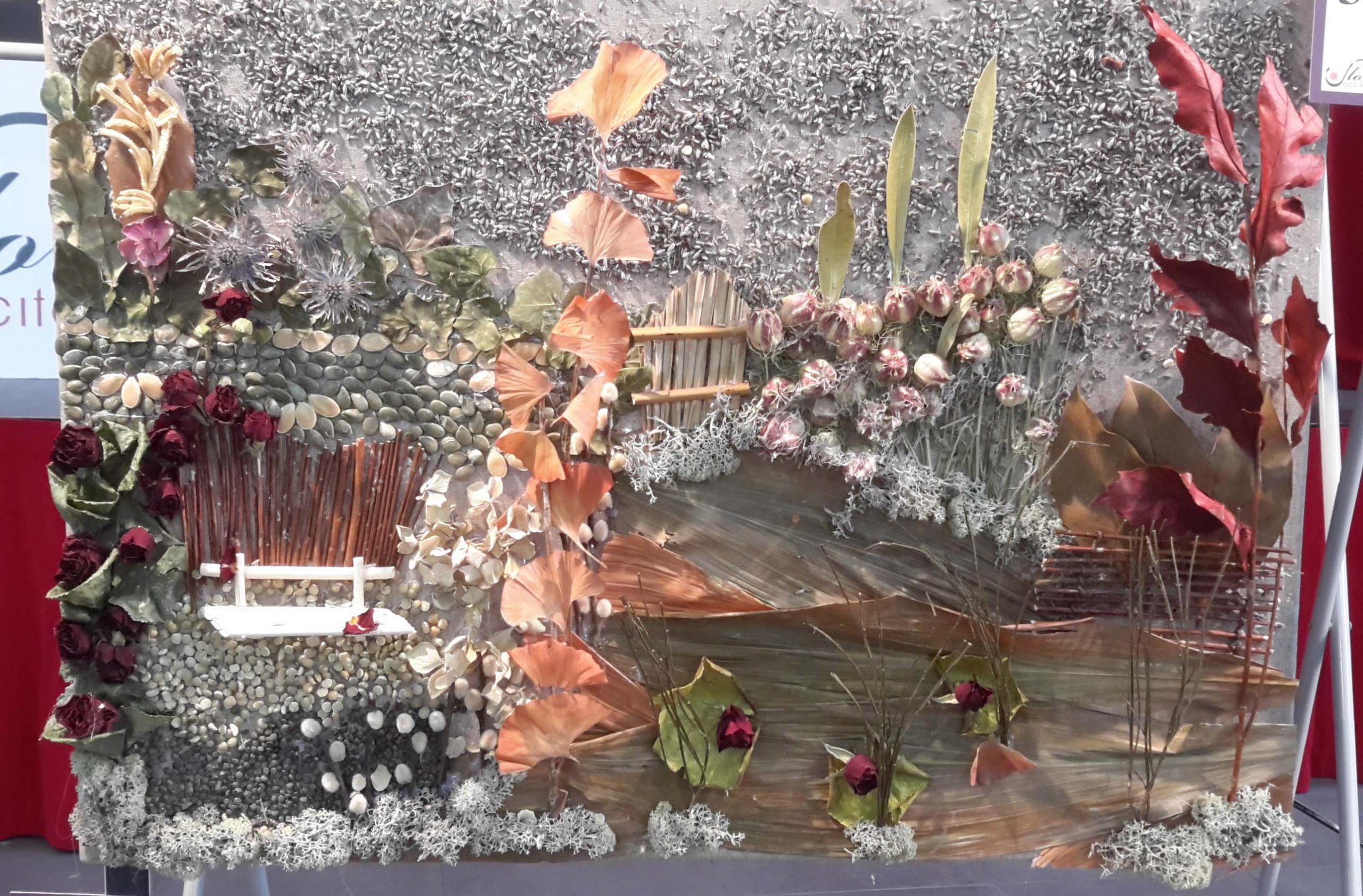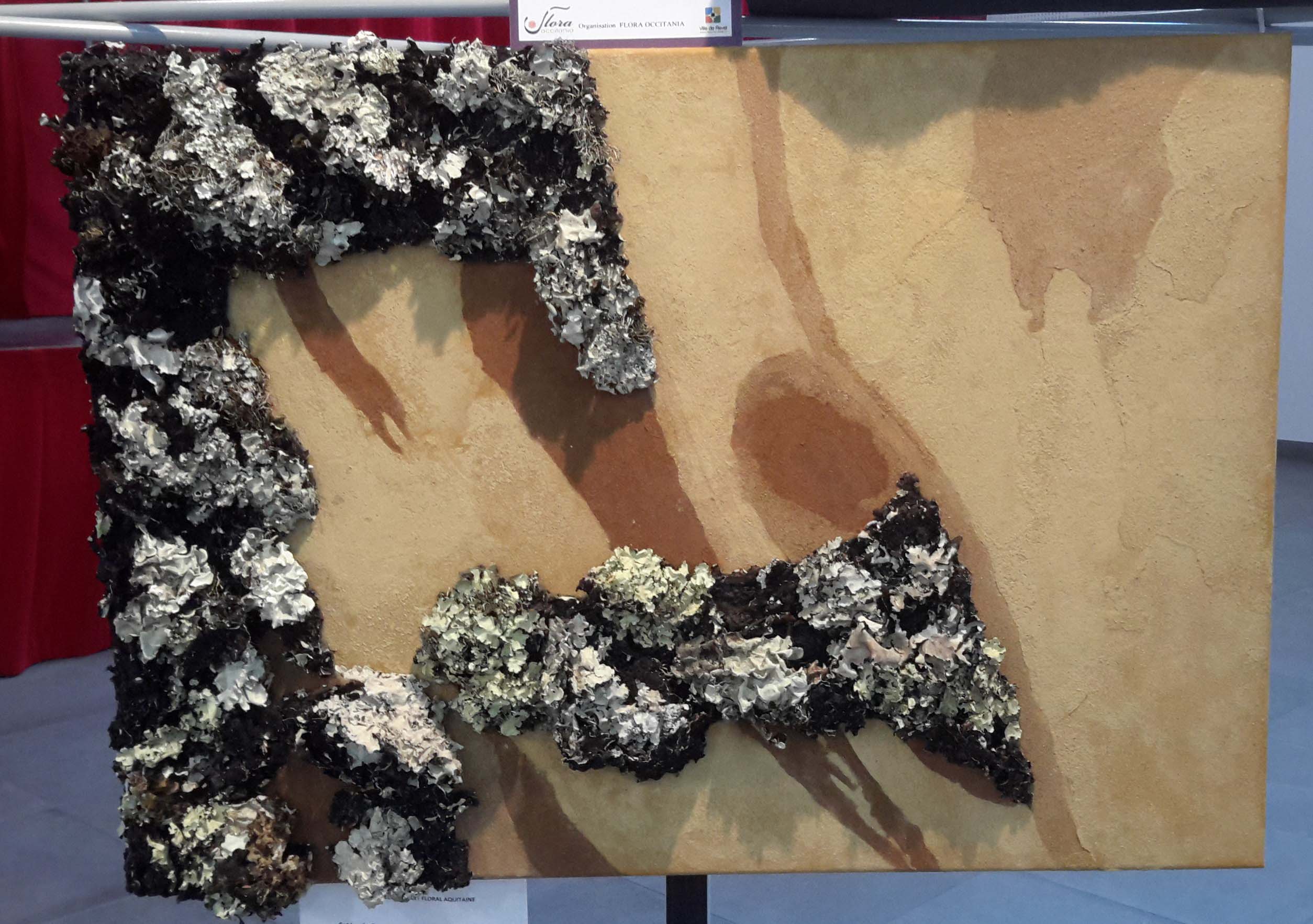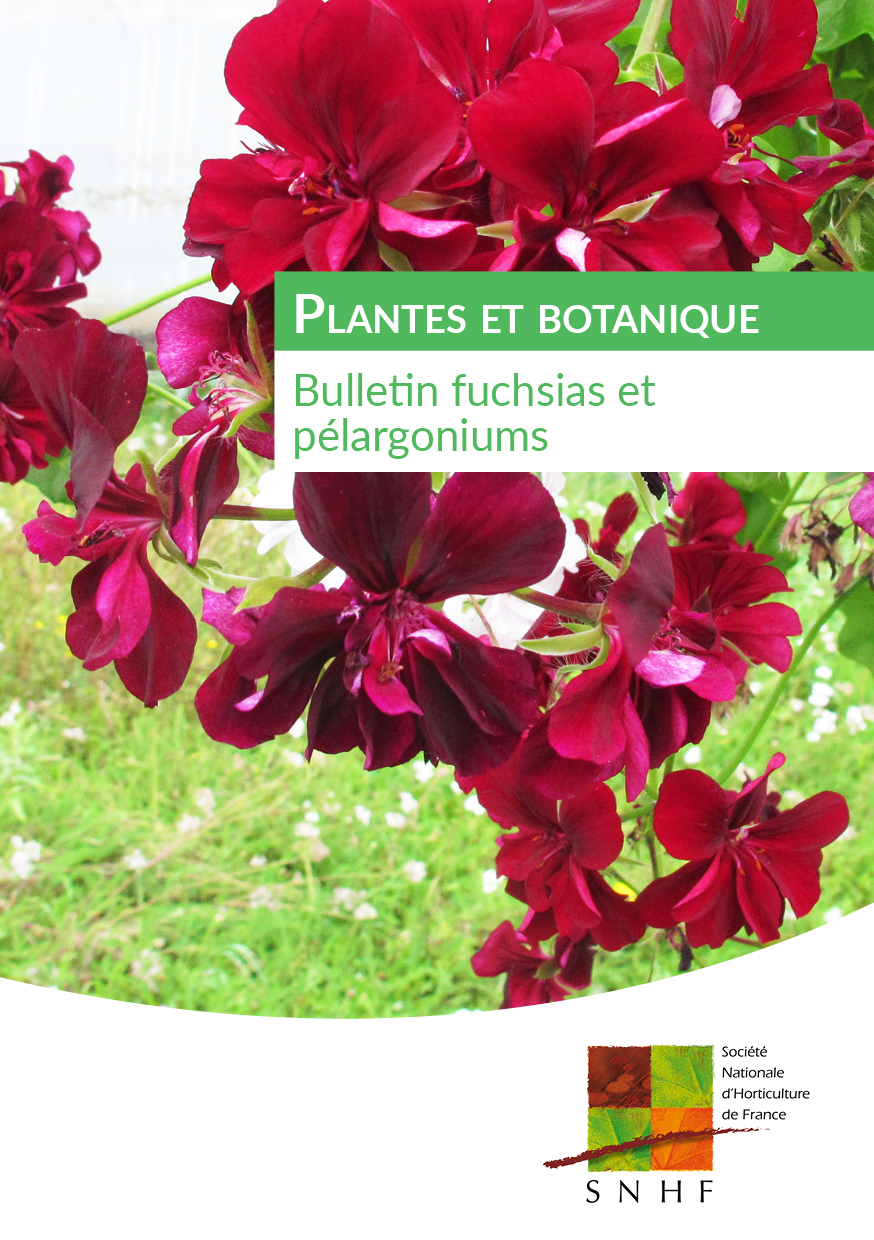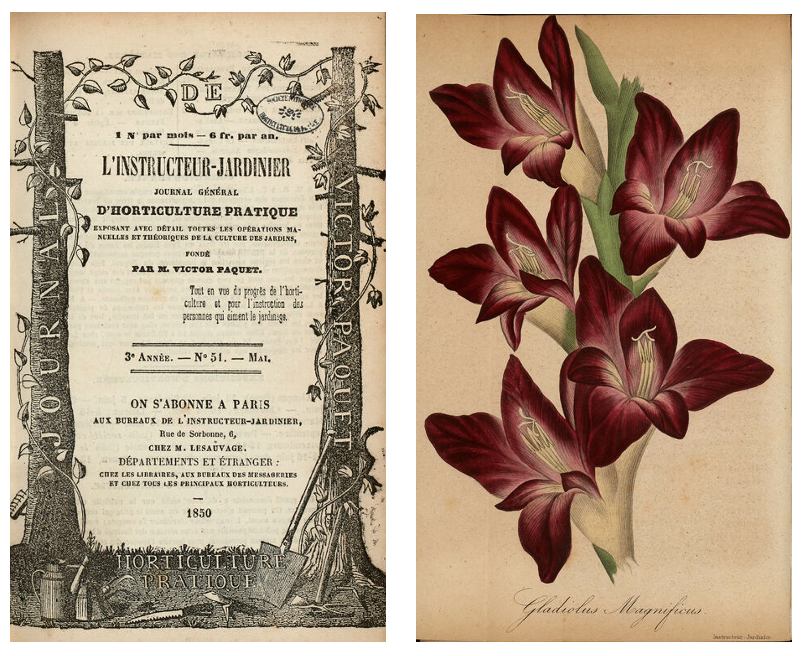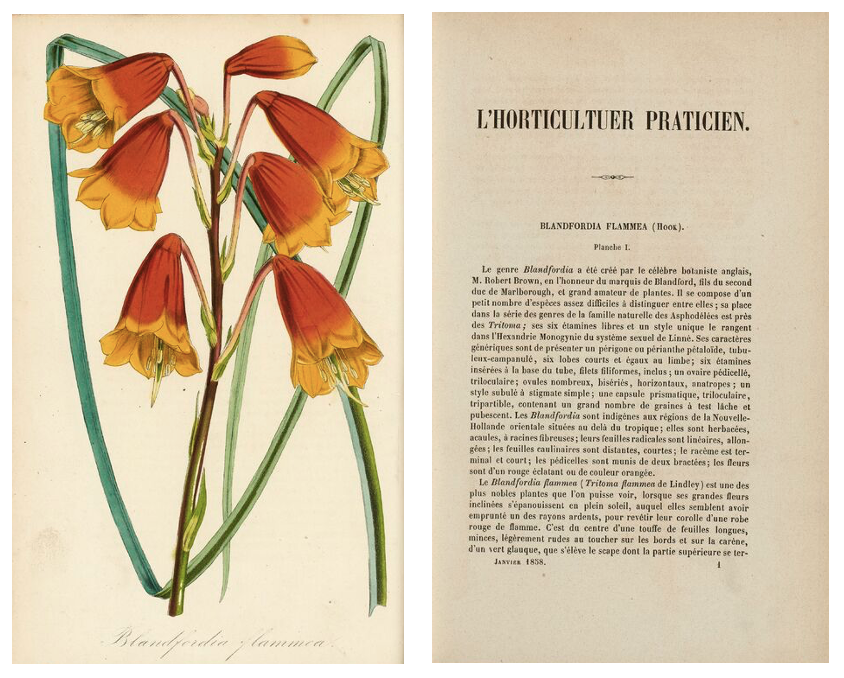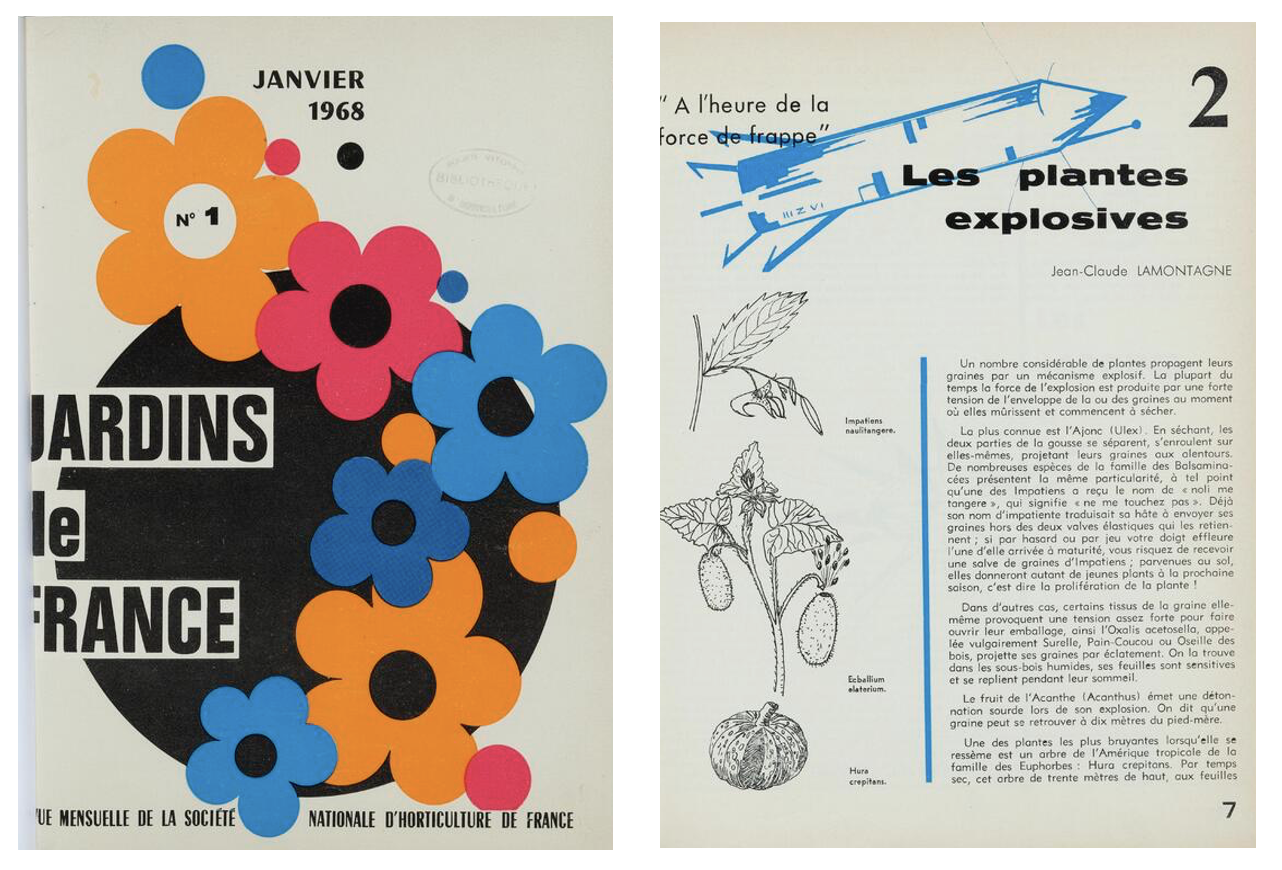[Webinaire] Comprendre pour tailler (conseil scientifique et section arbres et arbustes d’ornement)
Le programme
Le conseil scientifique et les sections de la SNHF mettent en commun leurs compétences pour vous présenter, par une série de webinaires, des espèces qui vous sont familières et sur lesquelles, vous voudriez en savoir plus. Ces webinaires, gratuits et accessibles à tous, se dérouleront en ligne.
Deux à trois spécialistes de la thématique partageront leurs connaissances, et resteront à votre écoute lors d’un temps d’échange où vous pourrez poser toutes vos questions. Nous vous attendons nombreux.
Le sixième webinaire de la série est organisé avec la section arbres et arbustes d’ornement!
Lundi 05 décembre de 14h 30 à 17h
Conférencier.e.s

Noëlle Dorion
Noëlle Dorion est ingénieur horticole et docteur en physiologie végétale. Elle a fait toute sa carrière professionnelle dans l’enseignement supérieur agricole d’abord comme enseignant chercheur en physiologie végétale appliquée aux plantes de l’horticulture à l’École Nationale Supérieure d’Horticulture (ENSH) de Versailles, puis comme professeur d’horticulture ornementale à Angers, d’abord à l’Institut National d’Horticulture (INH) puis à Agrocampus Ouest.
Elle a par ailleurs été présidente de la section « plantes ornementales, à parfum, aromatiques et médicinales » du CTPS (comité technique permanent de la sélection) et présidente de l’association Terre des Sciences.
Aujourd’hui retraitée, Noëlle Dorion est membre de la Société Nationale d’Horticulture (SNHF), membre de son conseil scientifique et membre de l’Académie d’agriculture de France.
Conférence : Quelles caractéristiques pour les ligneux d’ornement ?
Les végétaux ligneux d’ornement (VLO) ont pour première caractéristiques d’être des végétaux. En effet, les VLO sont des plantes comme les autres. Ils sont fixés et leur croissance harmonieuse, comme leur résistance à divers stress résulte de leur sensibilité aux facteurs de l’environnement et de l’intégration de ceux-ci dans la plante via les hormones notamment. Les VLO ont comme deuxième caractéristique d’être ligneux. Cette caractéristique associée à la capacité des bourgeons à être « dormants » pendant la mauvaise saison assure leur survie et prépare la croissance de l’année suivante. Cette pérennité de l’appareil végétatif est complétée par la possibilité de refleurir annuellement pour peu que la période de juvénilité qui est aussi une caractéristique des végétaux ligneux soit passée. Les VLO ont comme troisième caractéristique d’être ornementaux soit par leur système de ramification soit par leur floraison. Les signaux hormonaux qui commandent ces deux aspects sont les mêmes que ceux évoqués plus haut mais le résultat dépend aussi des caractéristiques génétiques des plantes. C’est pourquoi même s’il y a quelques grandes règles de ramification permettant de classer les VLO en arbres, arbustes et buissons, il existe une immense diversité tout à la fois avantage et difficulté pour le jardinier (exposés suivant).

Mary Fruneau
Mary Fruneau, passionnée de nature, est adhérente de plusieurs associations horticoles. Les échanges avec jardiniers et pépiniéristes, les visites de jardins et de fêtes des plantes depuis plus d’une vingtaine d’années lui ont permis de devenir, peu à peu, une « jardinière amateure éclairée ».
Après une carrière de professeure de Sciences Physiques en lycée, elle a pu donner libre cours à sa passion pour les arbres et arbustes dans son jardin, créé et entretenu à quatre mains : « Le jardin de Mary & Joël » https://sites.google.com/site/lejardindemaryjoeel/home?authuser=0
Présidente de la commission voyages de la SNHF depuis 2018, Mary est devenue administratrice, en 2021 et présidente de la section Arbres et d’Arbustes d’Ornement (AAO).
Conférence : Pistes pour le jardinier amateur
Pour diverses raisons, le jardinier amateur peut être amené à tailler les arbres et arbustes de son jardin. Il est alors souvent perplexe et se pose bien des questions : où et comment intervenir.
Quelques de repères concernant la floraison et la façon dont se développe l’arbuste permettent d’avoir les premiers éléments de réponse.
Après un rappel des notions de basitonie, mésotonie, acrotonie, le diaporama présentera divers arbustes correspondant aux modes de croissance définis, avec une indication sommaire de leur entretien.

Jac Boutaud
Jac Boutaud a été Gestionnaire du patrimoine arboré et forestier de la Ville de Tours (37) de 2008 à 2022[, date à laquelle il a pris sa retraite de la fonction publique territoriale]. Auparavant. Il a été Responsable du service technique pour les végétaux ligneux à Végétude (77) de 1991 à 2008. En parallèle, il est Formateur intermittent en arboriculture et arbusticulture d’ornement depuis 1992.
Concepteur et gestionnaire de l’Arboretum de la Petite Loiterie à Monthodon (37) depuis 1990 (https://www.lapetiteloiterie.fr/), il est l’auteur de l’ouvrage « La taille de formation des arbres d’ornement », édité la Société Française d’Arboriculture (http://www.sfa-asso.fr/) en 2005. Par ailleurs, il est membre fondateur et ancien président de l’association Les Arbusticulteurs (http://www.arbusticulteurs.fr/).
Conférence : Tailler les arbres et les arbustes : oui, lorsque c’est nécessaire, mais jamais sans « raison »
« La taille des végétaux ligneux d’ornement, qu’il s’agisse d’arbres ou d’arbustes, doit être décidée au terme d’une analyse non seulement de leurs modalités de développement, mais aussi de leur environnement, des contraintes qu’ils subissent et des objectifs qui sont poursuivis.
De même, le choix de la période de taille ne doit pas prendre en compte uniquement les modalités de floraison, il doit aussi favoriser une répartition équilibrée du travail au jardin au cours de l’année et, par ailleurs, respecter la nidification des oiseaux, en particulier dans la strate arbustive.
Cette démarche d’analyse préalable à la taille relève de la gestion raisonnée et non de l’entretien routinier. Elle permet d’éviter d’intervenir inutilement ou de façon inappropriée et elle replace le jardinier dans une position active et créatrice. »
Animateurs
Yvette Dattée présidente du conseil scientifique de la SNHF

Yvette Dattée
Docteur d’Etat, Yvette Dattée a été enseignant/chercheur à l’Ecole Normale Supérieure puis à l’Université pendant les 20 premières années de sa carrière. Elle est ensuite entrée à l’INRAe où elle a dirigé le GEVES (Groupe d’étude et de contrôle des variétés et des semences). Elle a présidé EUCARPIA l’association européenne d’amélioration des plantes de 1989 à 1992.
Aujourd’hui retraitée, elle est membre de l’Académie d’Agriculture de France et Présidente du conseil scientifique de la SNHF.